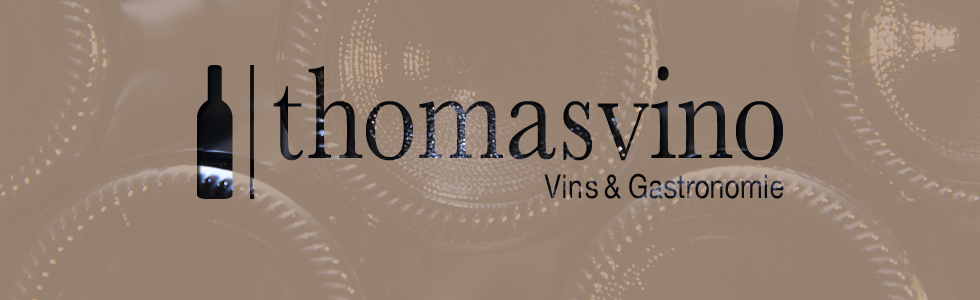Portugal — Le liège, de l’arbre à la bouteille
«Je viens d'une forêt du Portugal. On m'a levé au début de l'été. On m'a laissé reposer à l'air pendant deux ans. J'ai ainsi connu deux hivers, puis on m'a fait bouillir et j'ai gonflé en me demandant si cela allait s'arrêter. Puis, mis au repos, on m'a expliqué que ce passage était nécessaire pour me rendre plus sain. Aussi me suis-je gentiment livré au découpage à l'emporte-pièce. On m'a alors fait beau, trié, même parfois marqué. Et quelle fierté pour moi de porter des couleurs d'un grand nom de vin voire de son millésime.»
De quel étrange soldat ou martyr lusitanien parle Jacques Puisais, l'auteur du «Goût juste» (Flammarion, 1985), promu président de l'Académie Amorim, du nom du plus grand industriel de la branche? De ces 54 millimètres sur 24 millimètres de diamètre de liège, cylindre qui signe l'arrêt de longue vie ou de mort rapide d'un vin.
Le seul arbre dont l'écorce repousse
Ce vulgaire bouchon, qu'on jette négligemment après l'avoir pourfendu d'une vrille d'acier, vaut bien une tranche d'anthropomorphisme, tant le sort de l'homme et du bois, matière vivante, est intimement lié. Dans la nature déjà, car le liège, morceau d'écorce du Quercus suber , vit. Et même longtemps: deux siècles et demi à trois siècles. Sous réserve du sort de son âme, qu'on abandonne aux chantres de la dive bouteille, il meurt comme les humains. Et n'est bon, alors, ni meuble, ni cercueil, qu'à retourner à la terre, cendre ou poussière…
Le chêne liège connaît une puberté d'ado attardé. Vingt ans pour devenir productif, cinq ans pour acquérir une peau suffisamment élastique, avant d'être adulte. On le dit alors mâle. Puis femelle quand les hommes iront à la machette détacher, tous les neuf ans, son écorce en plaques épaisses — une opération appelée «démasclage».
Le chêne liège respire. Ses feuilles restent vertes toute l'année, ou plus exactement repoussent règulièrement, de sorte que dans l'Alentejo, au centre du Portugal, là où il peuple d'immenses forêts, quand on lève la tête, le feuillage dense cache le ciel, tandis que nos pieds foulent un tapis de feuilles brunes. C'est, aussi, le seul arbre dont l'écorce se reconstitue, lentement, mais sûrement.
Une essence méditerranéenne
Il lui faut un climat particulier pour se développer: il ne pousse que sur le pourtour de la Méditerranée et au Portugal. Là, cet arbre si étrange entretient un lien d'amour (et de haine, aussi, on le verra…), d'attirance et de répulsion, avec l'humidité des embruns atlantiques, plutôt que des brises méditerranéennes.
Aujourd'hui, le Portugal est le principal acteur du liège au monde: un tiers de la population forestière, mais plus de la moitié de la production mondiale de bouchons, soit, en tonnage, près des 15% des 200'000 tonnes de liège travaillées chaque année. L'Espagne suit d'assez loin (65'000 tonnes). Même si ses forêts sont vastes, le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) se contente de la portion congrue de bouchons, comme l'Italie et la France, où le climat de la Sardaigne et de la Corse conviennent bien au Quercus suberus.
Sept raisons d'être incomparable
Aux yeux d'un expert du vin comme Hugh Johnson (dans «Une histoire mondiale du vin», Hachette Pluriel, 1990), «aucun produit de synthèse ne peut remplacer le liège qui reste incomparable sur de nombreux points». Car il est léger, propre, imputrescible, chimiquement neutre, insensible aux variations de température et élastique, permettant une compression pour le bouchage, avant de retrouver son volume pour assurer une fermeture quasi-hermétique à la bouteille, épousant les irrégularités du verre. Et d'une durée de vie intéressante: vingt à cinquante ans: les premiers crus bordelais offrent à leurs acheteurs de les changer tous les quarts de siècle.
Pourtant, le liège a failli passer par pertes et profits aux oubliettes de l'Histoire. Les Egyptiens, les Grecs, puis les Romains, s'étaient rendu compte de ses remarquables propriétés. Ils l'utilisaient pour boucher leurs amphores. Mais le Moyen Age a renvoyé ces récipients à l'Antiquité, leur préférant les tonneaux de bois. Ceux-ci étaient fermés avec des tampons du même matériau, rendus étanches par un joint de lin huilé, de cuir ou de tissu.
Puisant dans la tradition locale, les Ibères gardèrent l'habitude — ou la retrouvèrent… — de boucher leurs fioles de vin avec du liège. Et c'est à des pèlerins rentrant de Saint-Jacques de Compostelle que l'on doit la pérennité du bouchon. Dom Pérignon, à qui la légende, sinon l'Histoire vérifiée, prête beaucoup, utilisait aussi le liège, dès que la «prise de mousse» fit du vin de Champagne un nectar effervescent. La fidélité au liège du champagne (et de ses innombrables imitations de part le monde) ne s'est jamais démentie, depuis.
Sauvé par la bouteille…
Au 17ème siècle, l'apparition de la bouteille, succèdant aux outres ou aux gourdes en tous genres, remit le bouchon au goût du jour, quand on s'aperçut que le verre scellé sur le contenant entraînait l'obligation de rompre le goulot pour libérer le breuvage, d'un seul trait. Un siècle plus tard, un ouvrage publié à Londres indique qu'«un bon bouchage est toujours à l'avantage d'un bon vin.»
De manière empirique, on s'aperçut aussi qu'il valait mieux coucher les bouteilles, pour garder le vin en contact avec le bouchon et empêcher ainsi l'air d'entrer dans la bouteille. Un conseil toujours valable! A l'inverse, tous les auteurs s'accordent à prétendre qu'un bouchon qui semble humide ne témoigne pas nécessairement d'un défaut du vin. Et l'on devrait, assure l'Anglais Johnson, à un de ses compatriotes l'invention du tire-bouchon, attestée, Outre-Manche, en 1681, mais qui n'apparaît en français qu'en 1718, selon le dictionnaire Robert.
Aujourd'hui, la recherche va toujours plus loin. A l'instigation des bouchonniers, des recherches sont menées pour mesurer l'échange qui se produit entre le vin et le bouchon. Selon des chercheurs bordelais, travaillant sous la houlette du professeur d'œnologie Yves Gloriès, le liège laisse passer une quantité infime d'oxygène. Il joue le rôle de catalyseur qui génère de lentes réactions oxydatives au cours du vieillissement du vin. Le bouchon permettrait aux molécules du liquide de se déplacer, ajoutant aussi des composés aromatiques et des tanins au vin.
…et menacé par la surproduction
Mais le combat séculaire du bouchon n'est pas gagné d'avance. Depuis dix ans, le Portugal, et les pays méditerranéens, ont dû faire face à une très forte demande, notamment des pays émergents, comme l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili ou l'Argentine. Les fabricants ont essayé d'y répondre par des subterfuges, comme le bouchon «un plus un», sorte de «sandwich» dérivé de la technique du bouchon de champagne: une fine rondelle de plein liège, à chaque bout, et de l'aggloméré de granulés de liège au milieu. Un bouchon très à la mode aujourd'hui. Comme l'est le synthétique dont le principal avantage, disent perfidement les bouchonniers, est de… ressembler au liège.
Avec une surproduction de vin annuelle de 20%, par rapport à la consommation mondiale, et autant de besoin de bouchage à satisfaire, la surface de chênes liège nécessaires devrait passer de 2,2 millions à 3,2 millions d'hectares d'ici 2015. Dans le même temps, le Portugal, encouragé par l'Union européenne, devrait doubler sa forêt (de 725'000 ha à 1,45 million d'hectares).
Bon pour l'écologie
L'écologie vient à la rescousse du liège, matière vivante. Pour le WWF international, l'aluminium des capsules de bouteille et le plastique des bouchons synthétiques sont plus dommageables pour l'environnement que l'utilisation du liège qui contribue à la sauvegarde des forêts méditerranéennes. Si les étendues de chênes liège ne sont pas jugées rentables, ces arbres sont alors arrachés au profit d'essence aux vertus moindres, comme l'eucalyptus ou le pin, appauvrissant l'équilibre d'un écosystème ancestral.
Malgré le «goût de bouchon» qui l'a menacé ces dernières années, le chêne liège n'est pas près de rendre son âme.
Eclairages
L'enjeu d'un fatal faux-goût
«Bouchon!» Quand l'exclamation retentit à table, le fautif est désigné sans appel à la vindicte du sommelier. «En cinquante ans, les vins ont fait d'énormes progrès. Nous n'avons pas suivi. Chacun est resté dans son coin», déplore, dans un mea culpa, un industriel portugais du bouchon.
Ce qui restait, il y a peu encore, dans une nébuleuse, a été identifié. Depuis vingt ans, les scientifiques ont pu déterminer que le «goût de bouchon» résulte de la présence de «2,4,6 trichloroanisol», abrégé en TCA. Une infime quantité suffit à communiquer un goût de moisi, combiné à de l'amertume. Un seul gramme dans 200 millions de litres de vin blanc suffirait! Il faut dire que le TCA a, selon des chercheurs de Changins, «un des seuils de perception olfactive parmi les plus bas connus pour le nez humain». Un autre, français, avance que 400 millions de bouteilles, soit 2% de la production mondiale, sont «atteintes» du «goût de bouchon» et irrémédiablement sacrifiées chaque année…
On sait désormais que le TCA est contenu dans le liège. Des chercheurs suisses et américains sont sur la même piste depuis quelques années. Ils soumettent les bouchons à une analyse par le biais d'un engin sophistiqué, qui procède à une chromatographie en phase gazeuse, couplée à un spectromètre de masse. La méthode n'est pas protégeable, explique Urban Frey, professeur de la Haute école spécialisée (HES) de Sion. Sur place, au Portugal, plusieurs fabricants se sont équipés de ce système de détection: chaque appareil coûte la bagatelle de 120'000 francs suisses.
Reste à connaître la cause de la présence de TCA: le «goût de moisi» provient certainement d'un développement de bactéries dans le chêne liège lui-même. Le bois en contiendrait, de manière latente. Et l'humidité renforcerait son développement dans le produit fini. Les fabricants ont donc éliminé les palettes en bois, pour éviter toute contamination, et les trempages inutiles. Ils ont remplacé le traitement au chlore, coupable de faux goût, par un lavage à eau courante et oxygénée (peroxyde d'hydrogène).
De leur côté, des chercheurs français ont mis au point un traitement du TCA par du CO2 «supercritique», un précédé utilisé, par exemple, pour ôter la caféine du café. Mais la mise en place de l'usine coûterait 15 à 20 millions d'euros… A Sion, Urban Frey reste sceptique: «Pourquoi enlever le TCA, alors qu'on sait qu'en prenant des précautions à la source on peut éviter qu'il y en ait?» Avec la société Chaillot Bouchons SA, à Allaman (VD), la HES de Sion va mettre en place un système de suivi du liège, du lot récolté en forêt au Portugal, jusqu'au sac de bouchons livrés au vigneron. Un code-barre accompagnera le liège durant toutes les étapes de la fabrication.
Il y a loin de l'écorce aux lèvres
Il y a d'abord la forêt. Dans les programmes de repeuplement, le Portugal favorise génétiquement les arbres qui «poussent droit». Ensuite, après la récolte, de juin à septembre, forcément manuelle, on évite de laisser les piles d'écorce jour après jour aux intempéries. Mais pas question d'utiliser le liège récolté avant un an de repos, où ses pores se resserrent naturellement. Ensuite, le liège est bouilli. Jusqu'il y a peu, cette opération se faisait après le transport du cœur du Portugal dans la région du Nord, près de Porto, à plus de 300 km de distance. Par tradition: le sud n'a que peu de main-d'œuvre qualifiée et les premiers clients de bouchons étaient, depuis la fin du 18ème siècle, les embouteilleurs de porto.
Plusieurs industriels ont délocalisé les premières opérations le plus près possible des forêts. Certains commencent même à y «tuber» les bouchons: une machine, actionnée par un ouvrier pousse à l'emporte-pièce les bouchons dans l'épaisseur de l'écorce. D'autres se contentent d'«aplatir» les plaques d'écorce: gain d'un tiers en volume par camion bâché.
Dans les usines (près de mille pour quinze mille emplois), ces bouchons bruts, on les ponce, les rogne, les chanfrène, puis on les lave à l'eau oxygénée, les blanchit, les sèche sous humidité contrôlée (dans un genre de sauna) pour les stabiliser; on les trie automatiquement et à l'œil (un travail féminin!).
«Dans le bouchon, comme dans le cochon, tout est bon, mais il n'y a pas que du filet de porc», explique plaisamment Marc-Antoine Druz, importateur et «finisseur» de bouchons. En liège plein, ils se déclinent dans une dizaine de qualités: une plaque de bel aspect donne 30% de beaux bouchons, 30% de moyens et 40% de faibles. Puis il y a les bouchons colmatés à la poussière (mélange de colle et de poussière de liège), les agglomérés (à base de granulé), ceux qui mêlent deux rondelles à chaque bout et l'aggloméré entredeux, les champagnes en plusieurs strates, pour résister à la pression de la bouteille… Les prix? De 3 centimes d'euros à 35 centimes pour la qualité «top», la fleur. Le reste de la poussière est récupérée et sert à chauffer les locaux et les autoclaves. Puis il y a les contrôles de TCA (voir l'encadré sur le «goût de bouchon») et la personnalisation, inscriptions diverses à l'encre ou au feu. Dernière étape: un traitement de surface au latex, pour éviter toute remontée du vin le long du bouchon, à la mise en bouteille, pour autant que le vigneron ne remplisse pas trop son flacon et la laisse debout 24 heures, pour laisser au bouchon «forcé» dans le goulot le temps de reprendre ses aises.
Bouchon? Haute définition
«Produit obtenu du liège
et/ou en liège aggloméré,
constitué d'une ou plusieurs pièces
et destiné à assurer l'étanchéité
des bouteilles ou autres récipients,
et à préserver leur contenu.»
Code international des pratiques bouchonnières (1996),
Confédération européenne du liège, Paris
Dossier paru dans Animan, magazine mensuel, Lausanne, en 2003